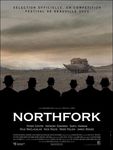L'ICEBERG un film de D.Abel, F.Gordon et B.Romy
 L’ICEBERG
L’ICEBERG
Recette de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy.
Préparée par Dominique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz…
Mis en boîte en Belgique, courant 2005.
Bouffé dans la nuit du 13 au 14 Juin 2009.
![]()
Fiona (Fiona Gordon) est manager dans un fast-food. Elle vit sa morne vie dans un morne pavillon de banlieue, entourée de Julien (Dominique Abel), son morne mari, et de ses deux mornes enfants.
Une nuit, elle se retrouve malencontreusement enfermée dans la chambre froide du fast-food. Traumatisée par cet événement, elle développe une étrange fascination pour le froid et la glace.
Un matin, elle abandonne mari et enfants, rejoint la côte et embarque à bord du « Titanique » accompagnée d’un marin sourd et muet (Philippe Martz). Son but : faire cap vers le Grand Nord et vivre sur un iceberg…
![]()
Regarder un film belge est bien souvent une expérience jouissivement déroutante.
Le cinéma de nos voisins aime en effet s’aventurer là où le nôtre ne met plus que très rarement les pieds : dans l’originalité et l’expérimentation. Malgré leur patrimoine audiovisuel plus que restreint, les belges savent en permanence réinventer leur cinéma, et lui donner des formes singulières et réjouissantes.
« L’Iceberg » en est un exemple de plus.
Il faut préciser que Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateurs et acteurs principaux du film, ne sont pas cinéastes. Leur métier, c’est plutôt le spectacle vivant, le travail des corps en mouvement, le cadre figé de la scène…
Pour mettre cela en image, ils se réapproprient une grammaire primitive du cinéma : celle des « Slapsticks » (courts métrages burlesques), où la caméra n’est qu’un œil immobile et où c’est le corps qui met l’image en mouvement. Alors que la plupart des films français actuels se résument en une succession de plans serrés, sur des visages censés suinter d’émotion, « L’Iceberg » s’inscrit à l’exact opposé. Presque chaque plan du film est un plan large, minutieusement composé, qui permet au corps des acteurs d’utiliser l’espace le plus intelligemment possible.
Alors que la plupart des films français actuels se résument en une succession de plans serrés, sur des visages censés suinter d’émotion, « L’Iceberg » s’inscrit à l’exact opposé. Presque chaque plan du film est un plan large, minutieusement composé, qui permet au corps des acteurs d’utiliser l’espace le plus intelligemment possible.
Bien loin d’intellectualiser cette démarche, Dominique Abel et Fiona Gordon s’en amusent et en font parfois même, un moteur comique.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’au lieu d’un simple mouvement de caméra, ils font se déplacer artificiellement tout un groupe de figurants, pour qu’au second plan, les personnages principaux soient toujours visibles.
Comme le prouve cet exemple, le travail sur les profondeurs de champs est particulièrement intéressant. Dans nombre de séquences, le  second plan sert de cachette. Des personnages y apparaissent comme par magie, alors qu’ils étaient cachés par un élément du premier plan.
second plan sert de cachette. Des personnages y apparaissent comme par magie, alors qu’ils étaient cachés par un élément du premier plan.
Mais il permet surtout de faire cohabiter deux personnages dans un même cadre sans que pour autant ils se croisent. D’où une accumulation burlesque de rendez-vous ratés et de fuites involontaires.
Inversement, beaucoup de plans n’ont aucune profondeur de champs. Les personnages sont condamnés à se déplacer de gauche à droite, ou de droite à gauche, dans un univers qui semble désespérément plat. Le cadre étant fixe, on les sent prisonniers lorsqu’ils sont seuls (Fiona dans la chambre froide), ou forcés à la collision et à la promiscuité lorsqu’ils sont plusieurs (les séquences de bateau).
L’univers sonore est aussi soigneusement réfléchi. Les personnages étant muets et leurs actions étant des plus primaires, les sons de la vie quotidienne paraissent amplifiés, surmixés et concourent au burlesque des situations. On ne peut s’empêcher de penser à Jacques Tati d’autant que, comme lui, les réalisateurs s’amusent à rendre incompréhensibles les phrases parlées. Ainsi, la narratrice de la première séquence s’exprime en Inuit, les employées du fast food par des onomathopées anglaises, Fiona exprime son mal être en parlant, la tête enfouie dans un oreiller… Le résultat est bien souvent hilarant.
La magie cesse pourtant de fonctionner, lorsque les personnages prononcent des paroles intelligibles. Les acteurs jouent faux, et même si c’est parfois touchant (les monologues de la grand-mère), c’est bien souvent agaçant ( la répétition sans fin des « Mais t’es où ? », le dialogue de réconciliation…).
agaçant ( la répétition sans fin des « Mais t’es où ? », le dialogue de réconciliation…).
« L’Iceberg » est en effet loin d’être un film parfait. Il a beau présenter un univers des plus attachants et il a beau être intéressant d’un point de vue esthétique, la trame du film est beaucoup trop décousue. Les séquences s’enchaînent sans réelle cohérence. Pire, elles ne sont parfois que prétexte à développer des gags dont l’intérêt est plus que discutable. Si bien qu’on finit par avoir l’impression de visionner un film à sketches.
Et comme dans tout film à sketches, il y a du bon et du moins bon…
« L’Iceberg » était le premier film de Fiona Gordon et Dominique Abel, épaulés par leur ami réalisateur, Bruno Romy. Depuis, ils ont récidivé avec « Rumba », un film beaucoup plus structuré mais tout aussi déjanté.
Nul doute que leur troisième film sera un chef-d’œuvre et que ces deux-là vont devenir de très grands faiseurs d'images…

![]()
(A venir)


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F1%2F516340.jpg)